Appel à communications
L’espace habité : appropriation(s), dépossession(s), résistance(s)
Introduction
Faisant écho à la sociologie urbaine héritière de la pensée marxiste au tournant des années 1970 (Lefebvre, 1968 ; Chombart de Lauwe, 1979) cet appel à communication interroge les tensions entre appropriation(s) et dépossession(s) dans la fabrique formelle comme informelle de l’urbain. Dépassant, par une approche critique, l’espace conçu des gestionnaires, Henri Lefebvre insiste dans Le droit à la ville, sur la production de l’espace par celles et ceux qui l’habitent, le vivent, le traversent. Il ne s’agit plus seulement d’avoir accès à la ville, mais de revendiquer le droit de se l’approprier, de participer à sa production, à son usage, à sa transformation. Observer l’espace habité, c’est ainsi révéler les rapports de pouvoir qui le traversent, qu’il s’agisse de politiques de patrimonialisation, de projets d’aménagement ou de rénovation urbaine. C’est aussi prendre en compte les formes de mise à distance ou de marginalisation, mais aussi les tentatives de réappropriation et de résistance qui redessinent les usages de la ville.
S’adressant à des doctorant·es issu·es de la sociologie mais aussi d’autres disciplines connexes telles que l’histoire, la géographie, l’anthropologie, l’urbanisme, l’architecture ou les sciences politiques, l’atelier se structure autour de trois axes complémentaires. Chacun éclaire la dialectique appropriation/dépossession à une échelle et par un prisme distincts.
Le premier axe propose d’explorer les expériences subjectives d’appropriation, de dépossession et de résistances vécues par les individus, qu’ils soient marginalisés ou non par le système urbain. Le deuxième axe se saisit, lui, de la dialectique appropriation/dépossession afin de questionner la recomposition des rapports de pouvoir au moment où la ville se pense, se veut, se fait « patrimoine ». Enfin, le dernier axe propose d’analyser les mobilisations collectives qui prennent place dans l’espace urbain en interrogeant dans quelles mesures elles constituent des manières de s’approprier ou de résister à la dépossession matérielle et symbolique de la ville.
Axe 1 - S’approprier, être dépossédé, résister : place aux expériences vécues
Ce premier axe interroge et souhaite faire discuter des communications concernant les expériences vécues d’appropriation(s), de dépossession(s) ou de résistance(s) de l’espace et dans l’espace.En effet, l’espace, pris dans sa dimension relationnelle (Low, 2015 ; Remy, 2015) est le théâtre de négociations, d’arrangements entre individus et leurs environnements (humains comme non-humains), mais aussi de gênes, de conflits, en somme de luttes des classes pouvant se muer en luttes des places (Lussault, 2009). Les communications pourront autant traiter de formes “ordinaires” d’appropriations et/ou de dépossessions, que des formes alternatives en réponse au modèle dominant, ou encore de ces mêmes processus à travers de recherches sur des populations invisibilisées et marginalisées.
Un premier sous-axe s’intéresse aux formes ou processus d’appropriation de l’espace habité au cours de la vie quotidienne (Lefèbvre, 2024). Dans la continuité des travaux menés en ethnographie urbaine (Collectif Rosa Bonheur, 2014), les communications pourront à la fois interroger les manières dont les habitant.e.s s’approprient ou sont dépossédés de leurs espaces de vie et comment ceux-ci sont traversées par des contraintes mais aussi des stratégies d’adaptation qui touchent aux différents territoires de vie. Dès lors, il s’agira d’interroger autant les formes existentielles de création d’un espace à soi et pour soi (Serfaty-Garzon, 2003), que des formes conflictuelles d’appropriation et de dépossession de l’espace urbain au quotidien. A l’instar des travaux de Pierre Gilbert sur la rénovation urbaine, cet axe laisse place aux propositions mettant l’accent sur les décalages entre espace conçu et espace vécu par les individus (Gilbert, 2016).
Ce second sous-axe interroge les enjeux d’appropriation, de dépossessions, de résistances de et dans l’espace – public comme privé – qu’éprouvent les populations subalternes. En effet, dans un contexte urbain capitaliste (Harvey, 2011), néolibéral (Pinson, 2020), patriarcal (Martinez, 2023), inadaptée aux enfants (Rivière, 2021) comme aux plus âgés (Buhnik, 2019), mais aussi aux personnes en situation de handicap (Fillion, Baudot, 2021), comment ces populations se trouvent-elles marginalisées dans l'accès, l'usage ou la conception de l’espace urbain ? Quels sont les éléments, les aménagements mais aussi les mécanismes qui participent de leur dépossession ? A l’inverse, comment ces personnes dépossédées mettent-elles en place des tactiques, des stratégies visant à résister, à s’approprier un morceau de vi(ll)e dans cet urbain inhospitalier ? (Carlier, 2018). Cet axe laisse également place à l’observation d’autres catégories de population à l’instar des personnes en situation de migration (Guérin, 2021) et/ou sans abris (Anderson, 2011). En effet, les communicants pourront par exemple questionner la dépossession à l’oeuvre pour ces personnes marginalisées autant que les modalités d’appropriation qu’elles mettent en place, pouvant parfois aller jusqu’à la création – certes précaires - d’un chez soi (Jouve, Pichon, 2015).
Axe 2 - Faire patrimoine : s’approprier les récits, s’approprier l’espace ?
Cet axe propose d’interroger la patrimonialisation comme un processus spatial et social où s’articulent des dynamiques d’appropriation et de dépossession. Loin d’être une simple opération de conservation, la patrimonialisation s’inscrit dans une logique de transformation de l’espace habité, générant des reconfigurations matérielles, symboliques et sociales (Choay, 1992 ; Bénos & Milian, 2013). Ce processus peut légitimer certains groupes sociaux tout en en excluant d’autres, dans une dialectique marquée par des rapports de pouvoir. Comme le souligne Garret (2014), « patrimonialiser, c’est s’approprier pour posséder ». Cette mise en patrimoine, souvent pensée dans un cadre institutionnel ou économique, favorise des usages différenciés (voire concurrents) du territoire, parfois en tension, notamment à travers les discours sur l’attractivité (Grossetti, 2022).
La patrimonialisation peut ainsi être appréhendée en miroir au processus de gentrification (Collet, 2015 ; Gravari-Barbas & Mermet, 2013), souvent justifiés par la « nécessité » de sauvegarder le patrimoine (Burgel cité par Clerval & Van Kriekingen, 2014). Certaines communications pourront se pencher sur des mobilisations citoyennes revendiquant une appropriation plus inclusive du patrimoine local (Zanetti, 2022). Pour autant, ce type d’exemple reste isolé au regard des pratiques d’habitants œuvrant conjointement à la patrimonialisation et à la gentrification (Corbillé, 2009). À partir de cette ligne de crête entre logique de conservation de l’espace bâti et reconfiguration socio-spatiale, certaines communications pourraient être consacrées aux formes de réactions par différents acteur.ice.s liées aux différents enjeux sociaux induits par la patrimonialisation. À l’instar de l’institutionnalisation du street-art qui oriente et intègre une pratique informelle dans un projet politique local (Olive-Alvarez, 2023).
Cet axe soulève également la question de l’appropriation par l’étude des formes de reconnaissances induites par la patrimonialisation et les mémoires invisibilisées. Les controverses récentes autour de monuments à connotations coloniales ou esclavagistes révèlent des luttes pour la reconnaissance et la relecture des récits historiques dominants (Bertrand & Bielawski, 2022). Ce phénomène invite à interroger la fabrique sélective de la mémoire, les discours autorisés (Smith, 2006 ; Cauwet, 2017) et la mise à l’écart de certains acteur·ice·s dans l’espace public. Une approche décoloniale du patrimoine, encore émergente dans la recherche urbaine (Boukhris, Peyvel, 2019) pourrait éclairer cette tension entre appropriation et dépossession en insistant sur les rapports de domination, les sélections mémorielles et les récits invisibilisés. Des propositions portant sur les effets socio-spatiaux des politiques patrimoniales, les conflits d’usages qu’elles génèrent seront les bienvenues. Les communications pourront également explorer les formes immatérielles du patrimoine, les récits situés, les enjeux de reconnaissances et les usages différenciés de la ville selon les appartenances sociales (Glévarec & Saez, 2002).
Axe 3 - Reprendre son droit à la ville : mouvements sociaux urbains aux prismes des enjeux de dépossession(s) et d’appropriation(s)
Le “désir d’appropriation” que suscitent ces “espaces urbains patrimonialisés” (Paulet, 2010) est susceptible d’être vecteur de contestations et à de mobilisations (par exemple, contre la démolition des pavillons Baltard, à Paris, en 1971). Cet axe invite à examiner les mobilisations qui prennent forme dans l’espace urbain, du fait des tensions qui s’y jouent entre dynamiques d’appropriation(s) et de dépossession(s). Elles peuvent s’inscrire pour ou contre un processus d’institutionnalisation, de patrimonialisation ou de gentrification, ou encore émerger afin de procéder à l’appropriation ou à la réappropriation des communs.
Les communications pourront traiter des mouvements sociaux qui prennent place dans l’espace urbain afin de lutter contre des projets, politiques ou processus qui ont pour effet d’en déposséder ses habitants, qu’il s’agisse de son usage, de son accès, ou encore de la marginalisation de certaines catégories de populations. A ce titre, on peut considérer les mouvements d’oppositions à des projets de transformation urbaine impliquant des processus de gentrification (Smith, 1986) ou encore certains grands projets d’aménagement (Tonnelat, 2022). Certaines communication pourront également se pencher sur les mouvements visant à la réappropriation d’espaces urbains par certains groupes ou individus, comme par exemple les occupations de squats (Aguilera et Bouillon, 2013), ou encore sur des formes plus globales de tentatives de réappropriation contestataires, à l’instar des “mouvements des places” (Guichoux, 2022). Une attention particulière pourra être portée aux pratiques d’appropriations collectives dans le sens du commoning, qui se développent en Europe occidentale à partir du début des années 2010, à la faveur de la crise économique, sociale et politique (Festa, 2016).
Enfin, les communications pourront s’intéresser aux relations ambivalentes entre les mouvements sociaux et les pouvoirs politiques, notamment quant aux négociations qui peuvent avoir lieu avec ces derniers et mener à des ajustements de l’une comme de l’autre des deux parties. En effet, si la négociation, voire la concession vis-à-vis des exigences des pouvoirs publics est un exercice pour de nombreux mouvements, la limite entre compromis et utilisation stratégique pour certains et compromissions pour d’autres, est fine (Bobbio et Melé, 2015; Zanetti, 2021). En ce sens, faire entrer les participants au cœur des logiques institutionnelles peut aussi apparaître comme une stratégie de “domestication” (Neveu, 2011) et de dépossession des citoyens de leurs revendications.
Bibliographie
-
Aguilera, T et Bouillon, F. (2013). Le squat, le droit de la ville en acte. Mouvements, 74, 2, 132-142.
-
Anderson, N. (2011). Le hobo, sociologie du sans abri. Armand Colin.
-
Bénos, R., & Milian, J. (2013). Conservation, valorisation, labellisation : la mise en patrimoine des hauts-lieux pyrénéens et les recompositions de l’action territoriale. VertigO, Hors-série 16.
-
Bertrand, R., & Bielawski, M. (2022). Dé-patrimonialisation. Journal des Anthropologues, 170‑171, p.229‑232.
-
Bobbio, L. et Melé, P. (2015). Introduction. Les relations paradoxales entre conflit et participation. Participations, 13(3), 7-33.
-
Boukhris, L., & Peyvel, E. (2019). Le tourisme à l’épreuve des paradigmes post et décoloniaux. Via. Tourism Review, 16.
-
Charmes, E. (2007). Les Périurbains sont-ils anti-urbains?. In Les Annales de la recherche urbaine, 102, 7-18.
-
Choay, F. (1992). L’allégorie du patrimoine. Seuil.
-
Clerval, A., & Van Criekingen, M. (2014a). « Gentrification ou ghetto » , décryptage d’une impasse intellectuelle. Métropolitiques.
-
Collectif Rosa Bonheur. (2014). Comment étudier les classes populaires aujourd’hui? Une démarche d’ethnographie comparée. Espaces et sociétés, 156-157.
-
Collet, A. (2015). Rester bourgeois : Les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction. La Découverte.
-
Corbillé, S. (2009). « Tourisme, diversité enchantée et rapports symboliques dans les quartiers gentrifiés du nord-est de Paris ». Genèses, 76, 3, 30-51.
-
Deville, D. & Nagib G. (2022) « L’agriculture urbaine et le droit à la ville à Paris et à Alès ». Justice spatiale, 17.
-
Festa, D. (2016). « Les communs urbains. L’invention du commun », Tracés. Revue de Sciences humaines, 16
-
Fillion, P.-Y. B. & E. (2021). Le handicap cause politique. La Vie des idées.
-
Garret, P., (2014). La défense du patrimoine architectural et urbain de Casablanca. Une tentative de « marocanisation » d’une ville trop moderne ? Dans La ville patrimoine. Formes, logiques, enjeux et stratégies, Presses Universitaires de Rennes. 57‑73.
-
Gilbert, P. (2016). Troubles à l’ordre privé : Les classes populaires face à la cuisine ouverte. Actes de la recherche en sciences sociales, 215, 5, 102‑121.
-
Grossetti, M. (2022). « L’attractivité, un mythe de l’action publique territoriale », Métropolitiques.
-
Guerin, L. (2021). L’appropriation spatiale comme résistance habitante : Ethnographie de résidences sociales issues de foyers de travailleurs migrants [These de doctorat, Paris 8].
-
Guichoux, A. (2022). Mouvements des places. In G. Petit, L. Blondiaux, I. Casillo, J.-M. Fourniau, G. Gourgues, S. Hayat, R. Lefebvre, S. Rui, S. Wojcik, & J. Zetlaoui-Léger (Éds.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation, DicoPart (2ème édition). GIS Démocratie et Participation.
-
Harvey, D. (2011). Le capitalisme contre le droit à la ville : Néolibéralisme, urbanisation, résistances. Éd. Amsterdam.
-
Jouve, É., & Pichon, P. (2015). Le chez-soi, le soi, le soin. L’expérience limite des personnes sans domicile fixe comme modèle de compréhension de la vulnérabilité sanitaire.
-
Korosec-Serfaty, P. (2003). Chez soi : Les territoires de l’intimité. Armand Colin.
-
Rosa Bonheur, C., Bory, A., Calderón Gil, J.-A., Cohen, V., Mortain, B., Muller, S., Verdière, J. et Vignal, C. (2017). Les garages à ciel ouvert : configurations sociales et spatiales d’un travail informel. Actes de la recherche en sciences sociales, 216-217, 1, 80-103.
-
Lefebvre, H (2009). Le droit à la ville, Economica, 135 p. [1968]
-
Lefebvre, H. (2024). Critique de la vie quotidienne.
-
Löw, M., Renault, D., & Bourdin, A. (2015). Sociologie de l’espace. Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
-
Lussault, M. (2009). De la lutte des classes à la lutte des places. B. Grasset.
-
Marmiroli, B. (2018). “Les jardins collectifs ont-ils droit de cité ?”. In Situ n°37 Consulté le 24 avril 2025, à l’adresse http://journals.openedition.org/insitu/19352
-
Martinez, C. (2023). La mise en politique du genre dans l’aménagement urbain. Une contribution à la cause des femmes? ENTPE.
-
Mermet, A.-C., & Gravari-Barbas, M. (2013). Commerce et patrimoine. L’exemple du Marais à Paris. Les Annales de la Recherche Urbaine, 108, 56‑67.
-
Neveu, C. (2011). Démocratie participative et mouvements sociaux : entre domestication et ensauvagement ? Participations, 1(1), 186-209.
-
Olive-Alvarez, A. (2023) « Construire une bonne pratique du Street Art : Production de standards et standardisation de la production dans les politiques municipales de l’art urbain », HispanismeS [En ligne], 22.
-
Paulet, J.-P. (2010). La France : Villes et systèmes urbains. Armand Colin.
-
Pinson, G. (2020). La ville néolibérale.
-
Rémy, J. (2015). L’espace, un objet central de la sociologie. érès.
-
Smith, Neil et Williams, Peter. Gentrification of the City. London: George Allen and Unwin. 1986.
-
Tonnelat, S. (2022). Convergence des luttes et diversité des tactiques La ZAD du Triangle de Gonesse dans l’agglomération parisienne. Politix, 139, 3, 65-93.
-
Zanetti, T. (2022). Mobiliser le patrimoine contre la gentrification à la Guillotière (Lyon) : une approche anarchiste du patrimoine ? Territoire En Mouvement Revue de Géographie et Aménagement, 53‑54.
|
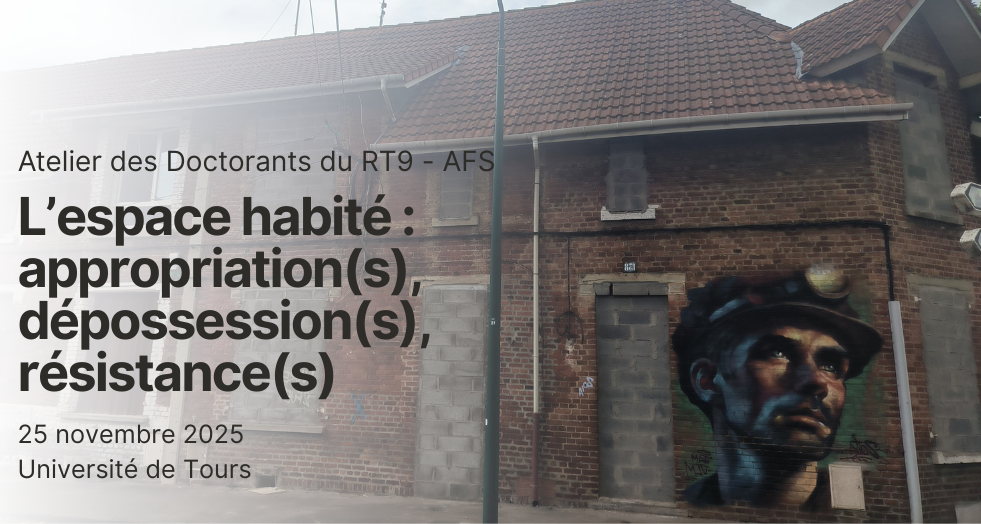
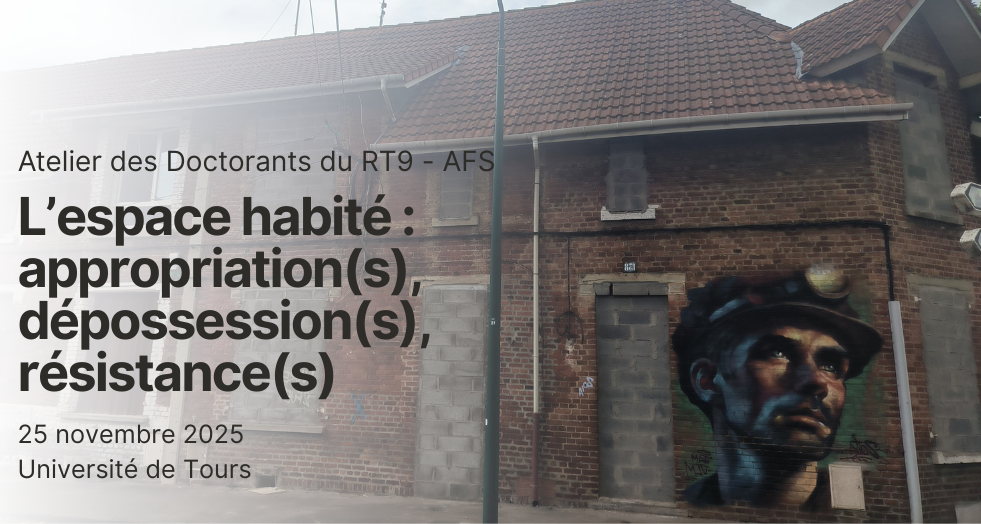
 Chargement...
Chargement...